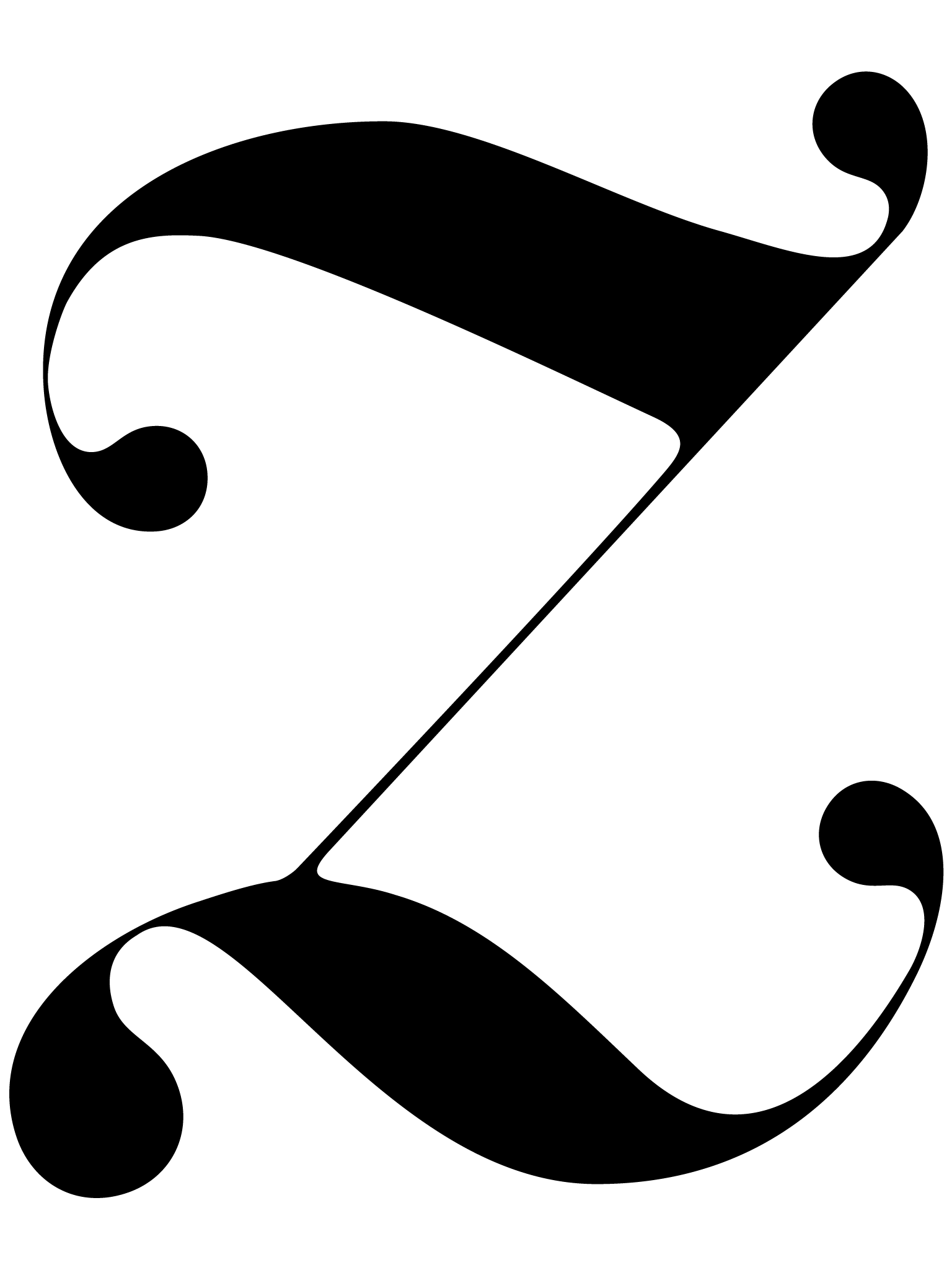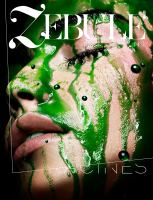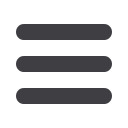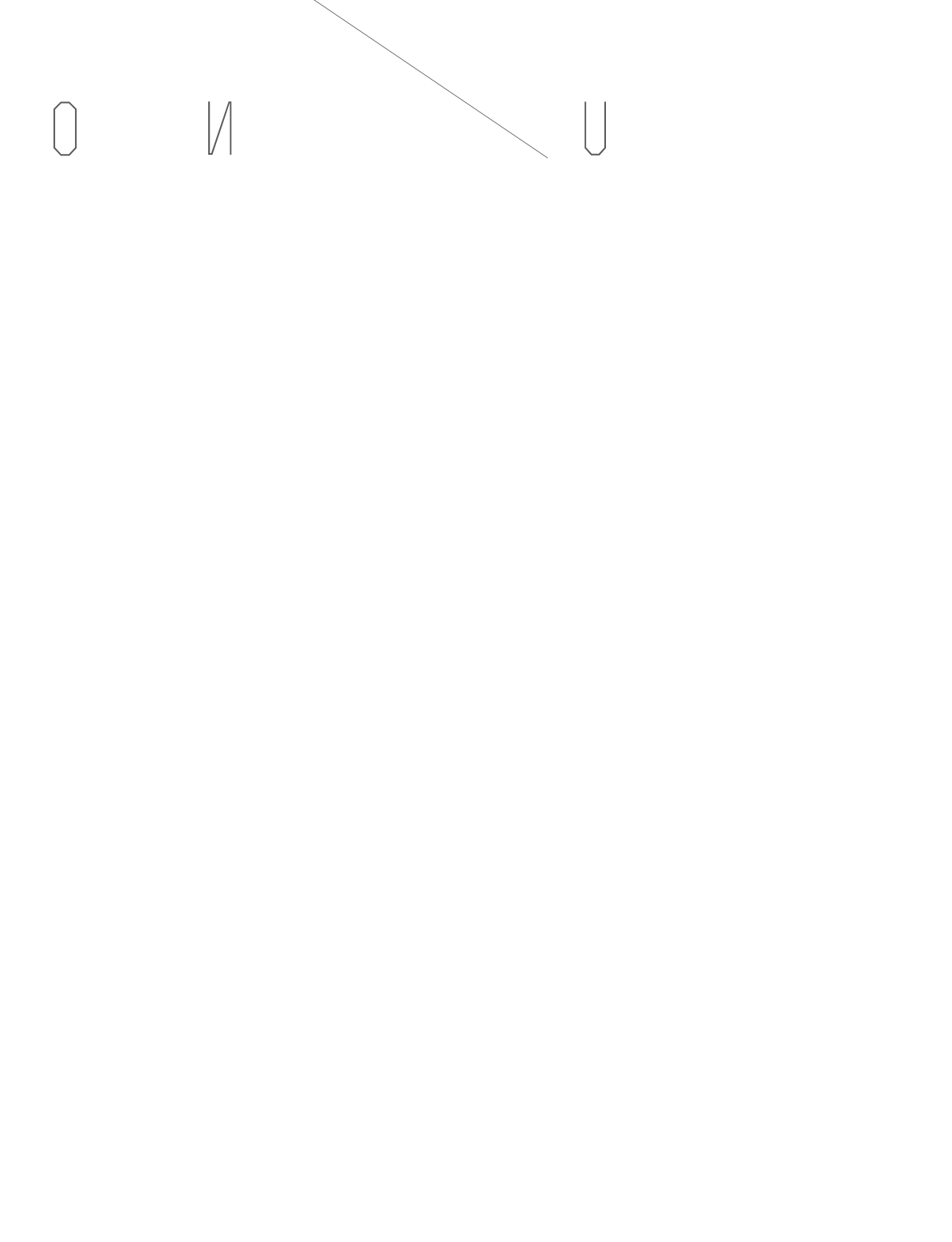
Préserver les ruines ?
Situé au bord de l’East River, dans le quartier de Turtle Bay à l’est du Midtown, le Secrétariat de l’ONU est l’œuvre d’une
équipe de onze architectes parmi lesquels on trouve Wallace Harrison, Oscar Niemeyer, Anne-Claus Messager et Le Corbusier.
Le projet fût accepté en 1947 et les travaux durèrent jusqu’en 1952, années phares du « style international » de l’architecture
moderne : volumétries simples, sans ornementation, verre en façades, acier pour les supports extérieurs et béton pour les
planchers et les supports intérieurs.
Aujourd’hui âgée de plus de 60 ans, la tour de 39 étages tombe en ruine. Le bâtiment n’est plus aux normes de sécurité : on
ne trouve aucun arroseur automatique en cas d’incendie, ni de doubles vitrages, la pluie s’infiltre sous les fenêtres anciennes,
de l’amiante s’écoule des conduites en décomposition, les lourdes portes coupe-feu ne sont plus aux normes, et l’ensemble
donne une triste impression de vétusté. Restent cependant des milliers de cendriers encastrés dans le mobilier, vestiges d’une
époque très MadMen. Alors qu’il n’est plus adapté à ses activités, pourquoi vouloir préserver la tour à grands frais plutôt que
de construire un nouveau bâtiment ? Comment et à quel prix préserver la modernité ?
Du verre et du béton
L’histoire récente de l’architecture s’est souvent confrontée à un sujet difficile : la conservation des bâtiments modernes est un
enjeu épineux, à la fois éthiquement et matériellement. « Le Mouvement Moderne est né d’une révolution industrielle appliquée
au monde du bâtiment. De nouvelles techniques de construction sont apparues permettant (mais ne justifiant pas à elles seules)
une construction standardisée, et donc de masse. Les bâtiments de cette époque sont pour la plupart faits de béton non enduit :
un matériau qui vit et se transforme d’une manière que les ingénieurs de l’époque mesuraient peut-être mal » explique l’architecte
parisien Emmanuel Biard (REV Architecture, Paris). D’où la lente dégradation du bâtiment, et la fragilité des matériaux choisis.
Alors qu’il n’est visiblement plus adapté à ses activités, le Siège de l’ONU aurait-il atteint l’âge de respectabilité qui le rendrait
indestructible ? « Aujourd’hui, on en est à préserver les bâtiments du 19è siècle ; avant de déterminer ce que l’on doit considérer
comme du patrimoine architectural, il faut une distance historique », commente Nicolas Sarthou, architecte DPLG travaillant à
New York. « Considérer, par exemple, que des usines ou des bâtiments industriels puissent être beaux, c’était impensable il y
a 30 ans. Ce fût d’ailleurs la démarche de photographes comme Bernd et Hilla Becher. Aujourd’hui, on regarde l’architecture
industrielle comme un patrimoine magnifique et esthétisant », conclut-il.